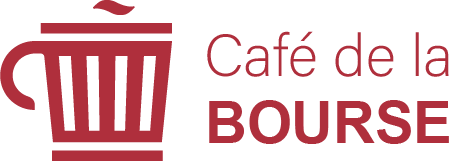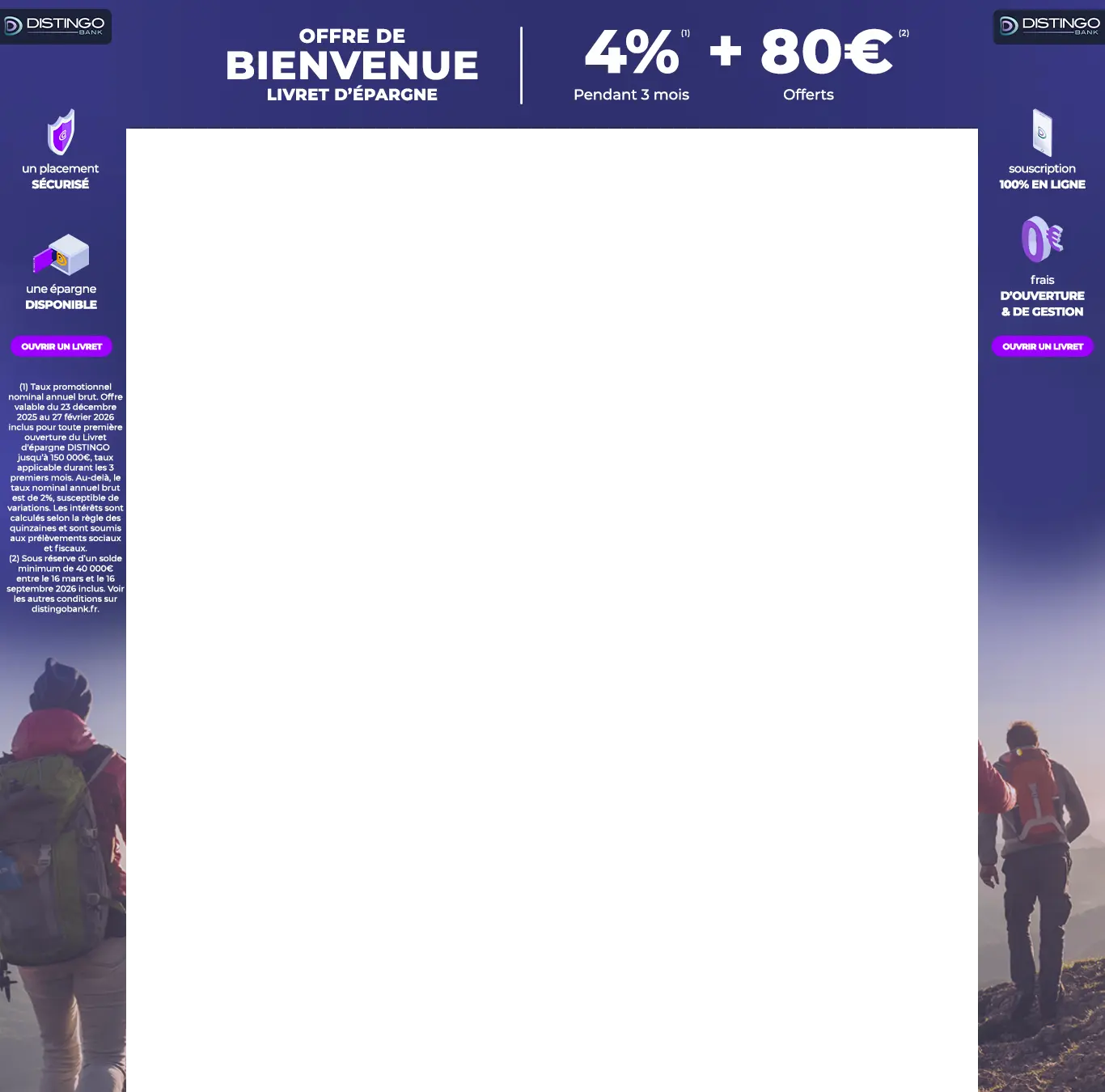

Les dessous du métier de chef économiste
Découvrez le parcours, l’expérience et le métier d’économiste en chef dans une plateforme d’investissement en private equity. Café de la Bourse vous invite à plonger dans l’univers de la finance de marché en interrogeant les hommes et les femmes qui y travaillent au quotidien.
Ce mois-ci, Mike O’Sullivan, Chef économiste chez Moonfare revient pour nous sur son activité, ce qui l’a poussé à faire ce métier, le fait le plus marquant de sa carrière et son sentiment de marché actuel. Un décryptage utile pour investir en Bourse.
Mike O’Sullivan, quelle fonction occupez-vous ? Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire le métier de chef économiste ?
Je suis actuellement économiste en chef chez Moonfare, et le chemin qui m’a conduit à ce poste a été particulièrement riche. Mon intérêt pour l’économie s’est affirmé très tôt, dès mes études à Cork, où j’ai obtenu une licence en économie et commerce. J’ai ensuite poursuivi avec un master et un doctorat à Oxford, ce qui m’a donné une base théorique solide et une ouverture sur les débats académiques les plus pointus. Mon premier poste a été celui d’enseignant en économie à Princeton. Ce fut une expérience intellectuellement stimulante, mais à ce stade de ma carrière, je n’étais pas encore prêt à me consacrer exclusivement à une carrière académique.
J’ai alors choisi de rejoindre le secteur financier, d’abord chez UBS, puis chez Credit Suisse, où j’ai travaillé pendant plus de dix ans et occupé la fonction de directeur des investissements. Cette immersion dans l’univers bancaire m’a permis de confronter mes connaissances théoriques à la réalité des marchés financiers mondiaux. Avec le recul, cette période a considérablement enrichi ma compréhension de l’économie appliquée : j’ai pu observer de près le fonctionnement des marchés, bénéficier d’un accès privilégié à une multitude de données, et surtout échanger au quotidien avec des collègues d’une grande intelligence, qui ont constamment nourri et stimulé mes réflexions.
Lorsque j’ai quitté Credit Suisse en 2019, j’avais une très bonne compréhension des marchés cotés (actions, obligations, devises). Mais j’ai aussi constaté un besoin croissant de la part des clients institutionnels, des family offices et des fonds souverains : celui d’accéder davantage au capital-investissement, au capital-risque et aux investissements directs dans des entreprises non cotées. J’ai donc consacré une grande partie des six dernières années au secteur des actifs non cotés.
J’ai donc passé une grande partie des six dernières années dans le secteur des actifs non cotés. Il y a deux ans, j’ai découvert Moonfare, qui m’a semblé être une excellente solution pour permettre aux investisseurs privés d’accéder aux meilleurs fonds de capital-investissement.
En tant qu’économiste, je trouve intéressant que les sociétés d’investissement sur les marchés cotés emploient de nombreux économistes et chercheurs, mais qu’il y ait relativement peu d’économistes travaillant dans les sociétés d’investissement non coté, me semble étrange car bon nombre des entreprises dans lesquelles ces sociétés investissent sont ancrées dans l’économie privée. Je pense que l’un des problèmes auxquels sont confrontés les économistes lorsqu’ils s’intéressent au capital-investissement et au capital-risque est qu’il est difficile d’obtenir de bonnes données. Là encore, chez Moonfare, nous avons la chance de disposer d’une équipe d’investissement qui a rassemblé au fil du temps des données approfondies sur les entreprises et les fonds.
Quel est l’événement que vous considérez comme le plus marquant de votre carrière ?
L’événement qui a marqué de manière décisive ma carrière est sans conteste la crise financière mondiale de 2008. Très tôt dans mon parcours, j’avais déjà traversé plusieurs turbulences : la crise économique asiatique, la débâcle de LTCM, puis l’éclatement de la bulle des dot-com. Ces épisodes ont été des expériences marquantes, mais ils restaient relativement limités par rapport à l’onde de choc provoquée par la crise financière mondiale. Pour des pays comme l’Irlande, pour le système bancaire dans son ensemble et, plus largement, pour l’économie mondiale, il s’agissait d’un événement presque existentiel.
Sur le plan professionnel, cette période a été d’une intensité rare. Elle m’a contraint à repenser beaucoup d’idées reçues et à m’interroger sur des questions fondamentales : le rôle des banques centrales, la solidité des marchés financiers, la manière dont les crises se propagent et se transforment. Cette expérience a profondément façonné ma vision des cycles économiques et du fonctionnement des systèmes financiers. Elle m’a également convaincu de l’importance de développer une approche analytique rigoureuse et critique, qui ne se contente pas de suivre les consensus dominants mais cherche à identifier les fragilités structurelles.
Cette réflexion se poursuit encore aujourd’hui. J’ai récemment travaillé sur un documentaire consacré à la dette mondiale et aux scénarios possibles d’une prochaine crise de la dette. Cet exercice intellectuel, mais aussi très concret, m’a rappelé combien il est nécessaire pour les économistes de maintenir une vigilance constante face aux déséquilibres financiers qui s’accumulent dans nos économies. Chaque crise passée nous enseigne qu’il ne s’agit jamais de reproductions exactes, mais que certaines dynamiques – accumulation excessive de dette, excès de confiance dans certains marchés, comportements mimétiques – tendent à se répéter sous des formes nouvelles.
Quel est votre indicateur préféré et pourquoi ?
Mon indicateur de référence est celui qui mesure l’appétit pour le risque : observe-t-on des flux vers des actifs risqués comme les actions ou le bitcoin, ou au contraire vers des valeurs refuges comme les obligations d’État et l’or ?
Quel est votre sentiment de marché actuel ?
En ce moment, mon sentiment à l’égard des marchés cotés est empreint de prudence. Prenons l’exemple du NASDAQ aux États-Unis : les valorisations y sont extrêmement élevées, largement portées par un petit nombre de grandes entreprises liées à l’intelligence artificielle. Ce phénomène crée une concentration inhabituelle, où une part disproportionnée de la performance dépend des résultats de quelques acteurs seulement.
À l’inverse, je me montre plus optimiste concernant le capital-investissement. Les valorisations y apparaissent plus raisonnables, et après une période de relative accalmie, l’activité repart progressivement. On observe une reprise des transactions, mais aussi un regain d’activité sur les marchés financiers en lien avec ce secteur, ce qui est encourageant. Pour un investisseur qui raisonne sur le long terme, le private equity conserve de solides atouts : potentiel de rendement, exposition à des entreprises innovantes et moins de dépendance à la volatilité immédiate des marchés cotés.
Il est clair que le contexte actuel reste marqué par des incertitudes géopolitiques et économiques, mais c’est précisément dans ces environnements que l’on mesure l’importance d’une diversification intelligente. Le private equity, en apportant une exposition différente et complémentaire aux marchés publics, peut jouer un rôle structurant dans les portefeuilles d’épargne à long terme.
Source des images : Freepik
Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l’utilisation de l’information fournie, sans qu’aucun recours contre la société éditrice de Cafedelabourse.com ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Cafedelabourse.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’erreur, d’omission ou d’investissement inopportun.
 Newsletter
Newsletter  Ebook
Ebook  Lexique
Lexique  Outils
Outils  Vidéos
Vidéos  Formation
Formation