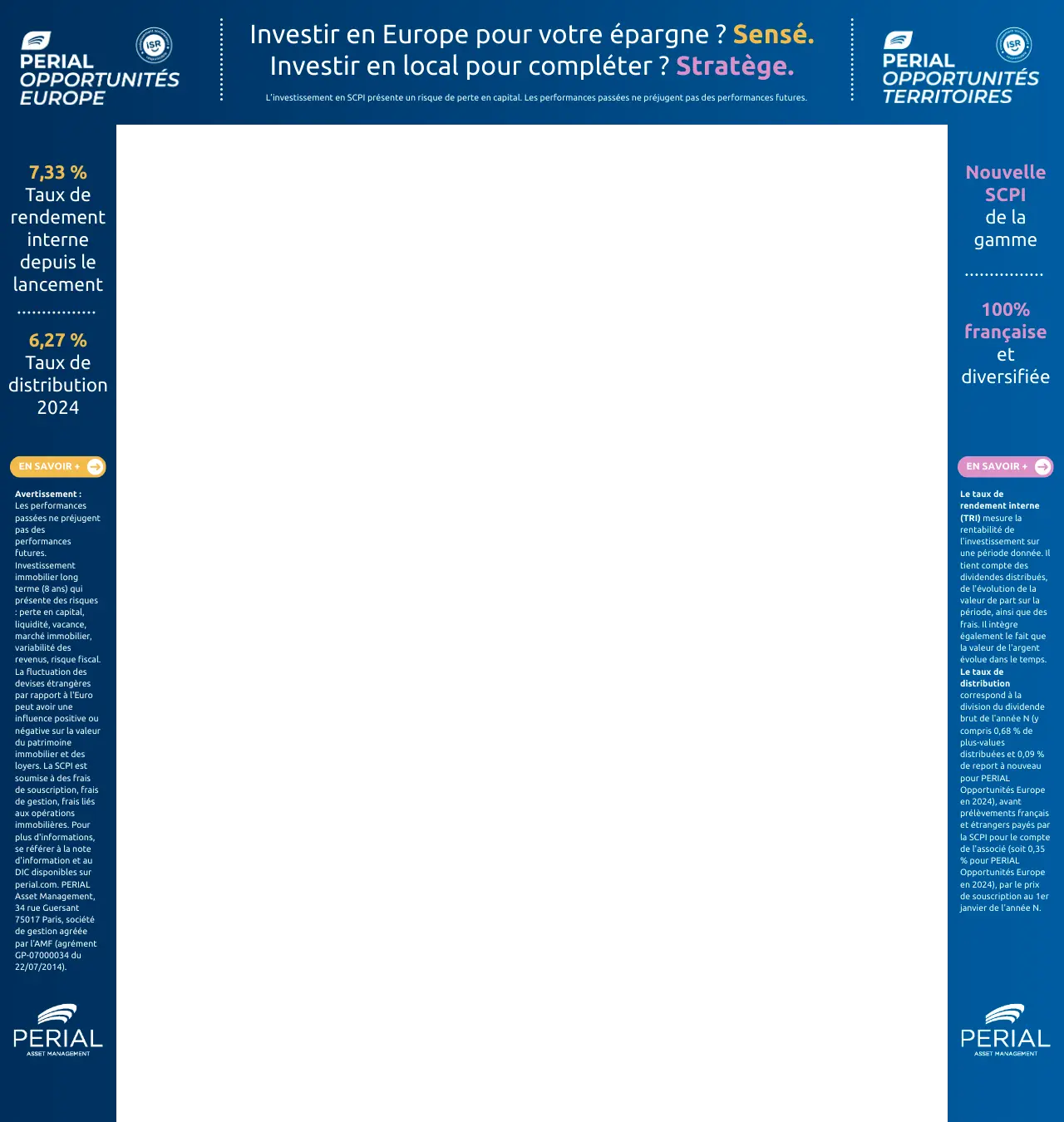
Dans cette crise dont les développements ne cessent de surprendre les observateurs, rien ne semble se passer comme les uns et les autres l’avaient prévu.
Ainsi par exemple, l’équipe Obama estimait que sans stimulus, le chômage atteindrait 9.2%, mais qu’il ne dépasserait pas 8% avec. Nous en sommes à 10.2%, et encore cela ne compte t-il pas l’énorme réservoir de travailleurs en temps partiel subi, et l’accroissement du nombre de personnes considérées comme sorties du marché du travail.
Et ce n’est qu’un indicateur parmi d’autres. Bien peu avaient prévu que les “injections” de monnaie de la Fed n’iraient pas provoquer un rebond des prix dans l’économie réelle mais une bulle totalement décorrélée de l’économie réelle sur les marchés d’actions. Quant à ce qui va se passer demain …
Impossible de trouver un consensus sur ce que sera l’avenir. Entre ceux qui voient la reprise et ceux qui pensent que nous n’avons vécu que le premier acte de la fin du monde, une gamme complète de scenarii se fait jour ; inflationnistes, déflationnistes, à la japonaise, à la façon de 1929, avec ou sans effondrement du dollar, ou de l’euro, et que sais-je encore.
Le propos de ce qui suit n’est pas d’expliquer ce qui va se passer (si je le savais, je serais riche), mais d’examiner les scenarii les plus négatifs et positifs possibles, et surtout, d’imaginer quelles sont les décisions politiques qui pourraient les favoriser ou les empêcher.
Point de départ des trois scénarios : poursuite de la crise bancaire
Le fait est que les banques américaines ne sont pas sorties de la crise et n’en sortiront pas de si tôt. On attend une nouvelle vague de lourdes pertes liées aux “resets” contractuels des prêts “prime” à taux variables, Alt-A, ARM, etc … Sans oublier des difficultés croissantes du côté des opérations de firmes de private equity financées par la dette (LBO), et des craintes lourdes du côté de l’immobilier commercial. Et, cerise sur le gâteau, le scandale MERS, qui pourrait gravement compliquer l’exécution des faillites bancaires.
Pour s’en tenir à l’immobilier résidentiel, environ 60% des maisons américaines étaient assorties d’une hypothèque, le crédit ayant soit servi à payer la maison, soit servi à consommer divers biens et services en apportant la maison comme garantie. Sachant que 8 de ces hypothèques sur 10 ont été originées ou rechargées pendant la bulle, on peut considérer que si les prix immobiliers reviennent à leur niveau d’avant bulle, voire, comme cela est probable, font un passage en-dessous, alors une bonne moitié des maisons américaines seront assorties d’une hypothèque restant due supérieure à la valeur de la maison… Pas rassurant, quand on sait que les ménages peu solvables (“underwater”) sont fortement incités, dans un tel contexte, à se mettre en défaut. Naturellement, tous les prêts “underwater” ne finiront pas en forclusion. Mais il n’y a aucune raison de penser que le pourcentage de ménages en retard ou en cessation de paiement de crédit se retourne prochainement.
Face aux premières difficultés, la réaction des pouvoirs publics a été assez consternante. Alors que la crise a été provoquée par un excès de crédit, la maison blanche a relancé fiscalement l’achat de maisons et de voitures… par le crédit, évidemment, et la Fed a baissé ses taux directeurs à zéro. Accessoirement, l’état a fait voter des dispositions encourageant les emprunteurs qui peuvent “difficilement payer” à se mettre en défaut. Et surtout, l’état a “sauvé” nombre de grosses institutions privées en transmettant leurs dettes aux contribuables : de cette façon, il empêche durablement le dégonflement rapide de la bulle de crédit à l’origine de la crise.
Résultat: tout cet argent artificiellement injecté dans les banques n’aura pas servi à financer le crédit non-subventionné, toujours atone. Par contre, à ce prix là, les banques ont pu se lancer dans des opérations de “carry trade” en empruntant à zéro et en spéculant sur des titres ou en achetant des bons du trésor à 3% et plus. Alors que l’économie réelle souffre, les grands établissements qui achètent de la dette publique US réalisent des marges miraculeuses sans effort, traduites par des rallyes boursiers spectaculaires … Mais ces valorisations ne correspondent à aucune création de valeur réelle : attention à la chute.
Résultat : deux bulles, l’une obligataire, l’autre sur les actions, se sont formées.
Tout le monde se demande pourquoi la multiplication par trois de la base monétaire des USA par la Fed n’a pas provoqué d’inflation : c’est parce que l’inflation monétaire a eu cette fois-ci pour symptôme un rallye totalement artificiel et déconnecté de l’économie réelle sur les marchés d’actions, et a permis aux banques de prêter de quoi financer les plans TARP et assimilés, dont le produit n’irrigue encore que très partiellement l’économie réelle.
En revanche, l’assèchement du crédit privé provoque une déflation immobilière en chaine: chute des prix des maisons, panique des emprunteurs, moins d’achats, moins de ventes, plus d’entreprises en difficulté, plans de réduction des coûts … Tout ceci se traduit par une explosion du chômage.
Scénario noir : écroulement déflationniste généralisé puis sortie par l’hyperinflation
Le premier scénario pourrait s’intituler “la loi de Murphy au carré”, ou le “stellar black swan”.
Pour sortir d’une vaste crise de déflation de l’économie non subventionnée, les entreprises existantes doivent d’urgence réduire leurs coûts ou périr. Leurs ressources sont donc consacrées à la réduction des coûts en priorité.
Pour que les chômeurs ainsi licenciés aient un espoir de retrouver du travail, il faudrait que d’autres entreprises se créent avec des offres tellement meilleures que ce qui existe actuellement que, même en période de crise, le public ne puisse y résister, ou que les entreprises existantes, non contentes de réduire les coûts sur leurs lignes existantes, continuent d’innover.
Tout ceci demande de l’argent. Or, le crédit est coupé, puisque les banques anticipent de nouvelles pertes. Elles conservent désespérément le cash que leur injecte la Fed et coupent le robinet du crédit pour réduire à la hache leur total de bilan. Le récent passage des taux de crédit à la consommation à 29.99% par Citigroup en est un révélateur.
Donc les entreprises qui voudraient investir dans le futur ne pourront pas le faire à crédit. Pourront-elles le faire par augmentation de capital ? Rien n’est moins sûr, car les besoins d’aspiration de l’épargne privée par un trésor US qui augmente son endettement à un rythme jamais connu jusqu’ici provoquent ce que l’on appelle un “effet d’éviction”. Autrement dit, tout ce que l’état fédéral aspire pour ses plans de “sauvetage” et de “relance” est perdu pour le financement de l’investissement privé.
Par conséquent, tant que le “deleveraging” de l’économie ne sera pas achevé, le chômage va s’accroitre, des personnes perdront leurs revenus, leur crédit deviendra trop lourd …
Ajoutons à cela que la période “d’accommodation comptable” des banques par la suppression des normes “mark-to-market” prend fin bientôt. Il est trop tôt pour dire ce que sera la norme “réformée”, mais il est probable que les banques devront recommencer à reporter de façon plus consistante qu’actuellement leurs pertes, réelles ou latentes.
Un scénario noir commencerait par une nouvelle grande faillite bancaire liée à ces conditions économiques désastreuses. Citigroup ou Bank of America sont deux bons candidats au massacre. Quand ? Courant 2010 ? Début 2011 ?
Cela provoquerait une nouvelle vague de panique qui ferait tomber les marchés d’actions à des niveaux peut être encore plus bas qu’en mars 2009, massacrant les bilans bancaires et ceux des hedge funds et des fonds de private equity. Paradoxalement, cela prolongerait encore un peu la capacité de l’état américain à creuser son déficit, le trésor étant alors perçu comme une valeur “refuge”. Mais très vite, les taux auxquels le trésor américain pourrait emprunter augmenteraient. Car l’état tenterait désespérément de sauver ce qui peut l’être par une fuite en avant dans les déficits, alors même que les recettes fiscales subiraient un nouveau recul massif.
L’arrivée en fin de droits de nombreux chômeurs, une nouvelle chute des rentrées fiscales obligeant états et cités à licencier massivement leurs services publics, et l’augmentation corolaire du nombre de SDF, pourraient laisser, à terme, 25% de la population sans revenus.
Naturellement, ces gens créeront leur propre emploi, et accepteront des boulots en-dessous du minimum fédéral simplement pour pouvoir manger, ou se chauffer l’hiver. Les salariés encore employés n’auront, quant à eux, aucun pouvoir de négociation sur leurs salaires qui stagneront ou diminueront.
Cela ne serait pas sans conséquences sur le maintien de l’ordre public.
On pourrait même voir un phénomène étrange : une fois la déflation du crédit achevée, et l’économie en miettes, le nombre de dollars remis en circulation par la Fed se révélerait incroyablement supérieur à l’offre productive sur le marché : nous pourrions donc assister non pas à une “stagflation”, comme dans les années 1970, mais à une “récé-flation”, comme au Zimbabwe… Les détenteurs de dette américaine seront bien sûr spoliés par cette inflation.
On peut même s’interroger si, dans une telle éventualité, certains états plus vertueux que d’autres ne verraient pas des revendications sécessionnistes se faire jour. Après tout, pourquoi le Texas, bien moins mal géré que la Californie ou la Floride, devrait-il supporté les conséquences d’un désastre créé par d’autres ?
Les USA renonçant, faute d’argent, à jouer les gendarmes du monde, celui-ci devient plus instable. Un conflit nucléaire majeur éclate au moyen orient, seul notre complexe de supériorité occidental et notre prudente tenue à l’écart feront que ce conflit ne sera pas baptisé “troisième guerre mondiale”. Le terrorisme connaît une nouvelle vague plus meurtrière que les précédentes.
De là à dire que le capitalisme cogéré par les élites financières et la haute fonction publique pourrait connaître une fin aussi dure que le communisme, je n’y crois pas, même dans mes moments de déprime les plus intenses. Le peuple américain est resté remarquablement discipliné lors des années 1930. Mais des épisodes “durs” ne sont pas impensables, avec des conséquences internationales assez imprévisibles.
Mais rassurons nous, ce scénario de fin du monde n’est pas, malgré les difficultés observables, absolument certain, ni même sans doute le plus probable, car la capacité de réaction des américains a toujours été exceptionnelle par le passé face à l’adversité. Simplement, ces scénarios ne sont pas aujourd’hui totalement impensables, ce qui devrait nous inciter à sérieusement réfléchir sur la façon de les éviter. Le pompier est d’autant plus efficace qu’il s’est entraîné contre les incendies avant qu’ils ne se déclenchent.
Scénario rose: des inflexions politiques salvatrices
Ce second scénario repose sur l’espoir d’un éclair de lucidité de l’administration Obama, lucidité fondée sur l’écart entre les prévisions économiques et les résultats observés, et le désir impérieux de tout politicien de se faire réélire. Il fait suite à une séance de réflexion basée sur une question simple: qu’est-ce qui pourrait faire rebondir l’économie américaine ?
La courbe ininterrompue de la hausse du chômage et l’amoncèlement de nuages sur les dettes bancaires, et sur la dette publique, fait prendre conscience à M. Obama que les conseils qu’il a écoutés jusqu’alors étaient mauvais. De plus, les négociations avec le congrès pour relever les limites du plafond d’endettement admissible de l’état prennent un tour inattendu: une majorité bipartisane exige de l’administration un vrai plan d’austérité budgétaire pour accepter un tel relèvement, que l’administration doit accepter pour éviter le défaut de paiement sur sa dette.
De surcroît, des barrières juridiques tombent, et des membres du congrès sont soumis à des enquêtes pour de supposées malversations durant la bulle des subprimes. Notamment, ceux qui ont bénéficié de trop de largesses du PDG de CountryWide, Angelo Mozilo, sont dans l’œil du cyclone, ainsi que Tim Geithner, l’ex-patron de la Fed de New York, englué dans le scandale AIG, qui est viré peu après les élections de mid-term.
Les tea parties reprennent de plus belle et lors de ces élections de mi-mandat, une dizaine de candidats libertariens, indépendants ou avec l’investiture du parti républicain, sont envoyés au sénat, et un nombre plus important encore à la chambre. D’ailleurs, ces candidats sont le plus souvent des ex-républicains qui comprennent qu’ils doivent sortir de l’ornière néo-conservatrice.
Dans ce contexte, une coalition d’économistes, et d’officiels tels que la patronne du FDIC, Sheila Bair, réussissent à provoquer un changement doctrinal pour faire promulguer des textes très forts interdisant le sauvetage gouvernemental des “too big to fail”. Une réforme importante du chapitre 11 appliquée aux établissement financiers, qu’ils soient assurés ou non par la FDIC, est adoptée à la quasi-unanimité des deux chambres. Promue par des économistes en vue tels que Luigi Zingales, Nassim taleb ou Janet Tavakoli, elle systématise les apurements de passifs de bilans bancaires par échanges de dette contre capital, ce qui pousse les établissements financiers à rechercher des négociations préalables d’urgence avec actionnaires et créanciers avant que de problèmes graves ne surviennent.
Entre 2011 et 2015, cette stratégie divise par plus de deux la montagne des dettes privées américaines. Les faillites bancaires qui surviennent avant ces réformes sont gérées suivant ces principes, car le trésor n’a plus les moyens ni la possibilité législative de lancer des bail-outs massifs, et le système financier tient, cahin caha, mais tient quand même l’année charnière 2010, après être passé à un cheveu de la catastrophe.
Résultat : l’amélioration des bilans des entreprises permet dès 2011 un très fort redémarrage de l’investissement.
La Chine, dont les excédents commerciaux avec les USA se réduisent, mais restent conséquents, multiplie les messages d’avertissement aux Américains, forçant ceux-ci à se montrer encore plus raisonnables, ce qui redonne confiance aux détenteurs internationaux de capitaux dans le futur de l’Amérique. Obama lui même comprend que sa réélection dépend de sa capacité à mettre en sourdine ses pulsions socialisantes, et passe un accord budgétaire bipartisan avec les libertariens du GOP et hors GOP, prévoyant une réduction rapide et drastique des dépenses et du déficit, grâce notamment à l’arrêt des aventures militaires étrangères tous azimuts, et la mise en place de chèques éducations partiellement financés par des fondations privées au plan national, qu’il fait avaler à son propre parti. Une réforme majeure de la “social security” (premier étage de retraite par répartition) est également adoptée, mettant à l’abri de la banqueroute pure et simple le trésor public.
Ce mouvement de maître achèvera de semer un peu plus la division au sein du GOP et assure à Obama une facile et assez brillante réélection en 2012, alors que tout le monde le donnait à la rue après les élections de mid-term 2010. Quelques années plus tard, dans ses mémoires d’ex-président, premier livre vendu sous différentes formes à plus d’un milliard d’exemplaires dans le monde, Obama écrira que ce changement stratégique lui a été inspiré par l’étude des changements de cap stratégiques de François Mitterrand en France lors de ses mandats, et par cette célèbre citation de Keynes: “When the facts change, I change my mind”.
Les investisseurs internationaux parient à nouveau sur les USA, non pas par charité pro-américaine, mais parce que les entreprises des pays émergents, comme la Chine, le Brésil, et l’Inde, décident d’investir massivement leurs excédents commerciaux dans le principal secteur susceptible de faire de leurs entreprises des “major players” dans le monde de demain, et non de simple copistes doués des recettes occidentales du passé. Ce secteur providentiel, c’est la fantastique R&D américaine, qui a tenu bon, grâce à des universités toujours à la pointe du progrès technologique, des fondations privées toujours actives malgré la crise, et des grandes entreprises qui ont soutenu à bout de bras cet actif vital dans les moments difficiles.
D’ailleurs, des progrès technologiques sidérants sont accomplis dans la deuxième moitié de la décennie 2010-2020, ce qui popularise les théories de “l’accélération perpétuelle du progrès”. Notamment, le stockage bon marché de l’électricité devient une réalité, occasionnant une véritable révolution énergétique. Les nano-technologies permettent de remplacer des métaux rares dans des dizaines d’applications. Des piles à combustibles à faible coût, des algues fabricant des pétroles de substitution, et bien d’autres nouveautés, révolutionnent les secteurs de l’énergie, des transports… Malgré l’abandon des politiques anti-CO2 sous la pression de révélations continuelles de fraudes scientifiques et financières ayant entouré la polémique du changement climatique, qui rejoint le trou dans la couche d’ozone au panthéon des grandes peurs millénaristes oubliées, le paysage énergétique mondial est paré pour un changement radical à l’aube des années 1920.
Mais la santé et le génie agricole ne sont pas en reste, pour le plus grand profit, là encore, du décollage économique des pays émergents. Le spectre des grandes pénuries de ressources constamment agité par les ennemis du progrès sont à chaque fois repoussés. Une fois de plus, le progrès technologique aura sauvé l’Amérique et le monde. Seulement, les USA ne sont plus l’unique puissance dominante mais doivent composer avec l’émergence des pays “new big and rich”, pour le plus grand bien de l’humanité.
Le chômage se résorbe, lentement certes à partir de mi 2011, puis à un rythme saisissant à partir de 2014, grâce à ces progrès. Une réforme discrète mais essentielle va y contribuer: sous l’impulsion d’économistes de renom, l’impôt sur les sociétés américaines voit son taux baissé mais sa base élargie des intérêts versés aux prêteurs (voir l’intérêt d’une telle réforme ici) ce qui fondera la croissance future sur la formation brute de capital et non sur les montages à base de fortes dettes tellement vulnérables aux aléas conjoncturels. On s’aperçoit par ailleurs que ce mode de croissance, plus sain, réduit la volatilité de la plupart des marchés financiers.
Les leçons de la crise sont en partie tirées, et les nouvelles régulations monétaires et financières, sans parvenir à l ‘idéal Hayekien ou Rothbardien, rendent plus difficile la reconstitution de bulles de crédit. Seuls point noirs: D’une part, les Smart Growth Policies, dont le rôle a été totalement sous estimé par la plupart des économistes après la crise, ne sont pas ou peu abrogées, et l’amélioration des conditions de vie des américains moyens provoquent de nouvelles bulles immobilières, moins fortes que celle que nous avons vécu, mais suffisantes pour maintenir dans la difficulté une frange résiduelle importante de la population américaine.
D’autre part, la monnaie reste une affaire planifiée, malgré les efforts des libertariens nouvellement élus au congrès pour abolir la Fed. L’accord passé avec Obama ne va pas jusqu’à achever la Fed. Des lois obligeant cette dernière à mieux appliquer certaines formules prudentielles évitent cependant de retomber dans les excès de l’économie à taux zéro. Mais à partir de 2020, de nouvelles bulles se reforment quand même, donnant au monde la désagréable impression que “décidément, le capitalisme ne se sortira jamais de ses crises”.
En 2016, après deux mandats, Barack Obama quitte la maison Blanche avec un statut de héros de l’Amérique, surpassant Roosevelt et Reagan en popularité, et se résout à accepter la dure condition d’ex-président qui n’a pu mener à bien son programme, mais qui a su en changer au bon moment. Ses tarifs de conférence d’après mandat atteignent des sommets. Obama est le prénom le plus donné aux USA en 2019.
Ce scénario me parait aussi peu probable que la fin du monde, mais il a le mérite de rester possible, au point ou nous en sommes: oui, les USA, et par la même le monde, peuvent encore se sortir du marasme, avec douleur, certes, mais sans passer par des épisodes aussi noirs que dans les années 1930 … Ou la guerre de sécession ! Si un conseiller francophone de M. Obama passe par ici, mes tarifs de conseiller politique sont disponibles sur simple demande.
Ma crainte, toutefois, est que même si l’administration Obama changeait de cap, elle le fasse trop peu et trop tard. Ce qui nous amènera aux scénarios gris.
Scénario gris : une sorte de stagflation japonaise
Ce troisième scénario, c’est vous qui le bâtirez, en mélangeant les ingrédients des deux premiers. Dire que c’est le plus probable, dans ces conditions, relèverait de l’escroquerie intellectuelle: la plage de scénarios “gris” rendus possibles par cet artifice fait que la réalité se situera avec un intervalle de confiance de plus de 9 chances sur 10 dans ce ventre mou.
Dans les grandes lignes :
Les USA verront la bulle de crédit se dégonfler lentement, faute de politique de désendettement claire de l’état et de la sphère financière, qui louvoiera entre keynésianisme idéologique et rémissions pragmatiques partielles dictées par l’état des finances et les menaces d’emballement des taux obligataires. Le change euro dollar sera plus volatile que jamais, sans qu’on y fasse plus guère attention. Faute de s’attaquer à la bulle de crédit à la hache, la crise trainera en longueur, des phases de rémission de l’économie financière alternant avec des rechutes dépressionnaires.
Cette politique du louvoiement de Barack Obama lui vaudra un désaveu des électeurs en 2012, mais son successeur, un illustre inconnu républicain conservateur mou sans saveur ni convictions, surgi de nulle part, ne vaudra guère mieux, le mouvement libertarien n’ayant pas encore pu établir des bases politiques suffisantes pour s’imposer. Ce n’est qu’à partir de 2020, dans un monde rendu instable et en proie à plusieurs conflits de moyenne intensité, que le travail d’éducation patient et inlassable des économistes et philosophes libéraux autrichiens commencera à payer, et que le monde marchera à nouveau vers l’avant.
Les avancées technologiques permettront de réaliser des gains de productivité tout juste suffisants pour permettre à l’économie de tenir cahin-caha, comme cela a été le cas pour le Japon pendant ces 20 dernières années.
Pour les détails, qui vivra verra.
Et la vieille Europe, dans tout cela ?
Je l’avoue, bien qu’y vivant encore et n’ayant guère de perspectives de la quitter, je n’arrive pas du tout à m’intéresser à l’Europe, et aux économies européennes dans leur ensemble. En fait, une divergence profonde entre pays correctement gérés pendant la crise et pays budgétairement déficients parait plus que probable, mais les barrières linguistiques et réglementaires à la libre circulation des citoyens rendront l’adaptation géographique plus difficile qu’en Amérique, où quitter la Californie pour le Texas est une opération assez simple. Considérer l’Europe comme un ensemble économique unifié me parait encore être une simplification abusive. Par conséquent, les conditions du scénario rose des différents pays sont plus difficiles à analyser.
Notre bonne vieille France, quant à elle, est menacée par Fitch de perdre sa note AAA sur sa dette, mais nos gouvernants ne parlent que de “grand emprunt”. Quel symbole de désordre intellectuel de nos élites ! Ce pays magnifique mais pitoyablement géré par des cliques politiques trop lâches pour mener les vraies réformes qu’elles savent pourtant nécessaires vivra forcément, dans les années à venir, des chocs économiques de grande ampleur, qu’ils soient subis ou provoqués par un sursaut d’austérité gouvernementale contraint et forcé par le spectre de la banqueroute.
Malgré le génie créatif qui semble encore animer quelques entrepreneurs de nouvelle génération (mais pour combien de temps encore ?), le scénario rose de l’économie française paraît difficile à imaginer dans l’état de délabrement politique qui est le nôtre.
Il va falloir se préparer à des temps très, très difficiles.
Vincent Benard
 Newsletter
Newsletter  Ebook
Ebook  Lexique
Lexique  Outils
Outils  Vidéos
Vidéos  Formation
Formation 

